21/03/2006
Dissert poésie
Une proposition de correction pour le sujet suivant :
Discutez et commentez la formule de Musset " La poésie est une langue que personne ne parle mais que tout le monde comprend", en vous demandant notamment si elle peut s'appliquer aux diverses générations de poètes.
**************************************
Tout en proposant au fil des siècles et des civilisations des formes poétiques qui ont accompagné la vie des hommes et l’histoire de leurs sociétés, les poètes n’ont jamais cessé de s’interroger sur la nature de ce langage particulier dont ils semblent être les dépositaires. Qu’est-ce que la poésie ? Peut-être pourrait-on dire qu’il y a autant de définitions que de poètes. Musset, poète emblématique de la sensibilité romantique rappelait que " la poésie est une langue que personne ne parle, mais que tout le monde comprend ". Etonnant paradoxe, à première vue, que d’évoquer une langue que l’on pourrait comprendre sans savoir la parler… C’est pourtant bien au cœur de ce paradoxe que la poésie trouve peut-être sa meilleure définition. Nous confronterons cette définition aux évolutions poétiques qui ont marqué l’histoire de ce genre littéraire pour voir en quoi la poésie est un langage particulier qui peut nous paraître une langue étrangère, puis comment nous parvenons néanmoins à accéder à sa signification.
Dans sa très longue histoire, la poésie a souvent pris des formes diverses, mais dans tous les cas il semble bien que chaque fois elle se caractérise comme une langue " à part ", une langue à l’écart de l’utilisation triviale et utilitaire. Cette langue, Musset prétend que " personne ne (la) parle ".
Dès ses origines, la poésie est marquée du sceau de l’étrangeté. Il ne s’agit pas d’un simple moyen de communication mais d’une langue réservée à des initiés, dans un cadre souvent rituel et religieux. On peut imaginer que les premières manifestations de cette langue particulière furent les paroles plus ou moins incantatoires des chamans, sorciers, druides, ou autres personnes investies d’un rôle spécial dans la communauté des hommes. Par cette langue, chantée ou scandée, il s’agissait d’entrer en communication avec des forces supérieures, des divinités, pour tenter de s’en attirer les bonnes grâces ou pour entourer les rituels funéraires. Langue d’une caste, perpétuée par une transmission réservée à quelques uns, la poésie établit une hiérarchie entre ceux qui la pratiquent et ceux qui la reçoivent. En Afrique aussi, par exemple, le " griot " a toujours eu une place particulière dans la tribu ou l’ethnie par sa capacité à délivrer une parole à laquelle on accorde certains pouvoirs. Parole d’ailleurs transmise en des lieux également particuliers : dans une grotte ou sur un tumulus en Europe, au pied d’un baobab ou autour d’un feu en Afrique…
Cette langué d’initiés a des caractéristiques formelles qui la distinguent de la langue " de tous les jours ". Il s’agit notamment de tous les procédés fondés sur le rythme : mètre régulier, rimes etc… Parce qu’elle a longtemps été un texte chanté — comme en témoigne le mythe grec fondateur de la figure du poète : Orphée et sa lyre — la poésie se présente traditionnellement comme une utilisation musicale du langage. Les assonances des décasyllabes dans le long poème épique La chanson de Roland permettait au jongleur-conteur de scander le texte, de le faire résonner, mais aussi de le retenir plus facilement. Cette caractéristique a accompagné l’évolution du genre à la Renaissance quand la poésie est aussi devenue un texte lu silencieusement et individuellement tout autant qu’entendu collectivement. Faire des vers, parler en vers, ce n’est évidemment pas une pratique courante, et c’est ce qui distingue habituellement le genre poétique de tous les autres genres dits " prosaïques " parce qu’ils utilisent une langue plus commune. A ce titre, comme le dit Musset, voilà une langue que " personne ne parle ", hormis les poètes bien sûr…
Pourtant, la modernité a bousculé la tradition poétique en inventant le " poème en prose ". Alosyus Bertrand, Rimbaud, Baudelaire, furent les précurseurs d’un genre que presque tous les poètes du XX ème siècle ont pratiqué, dans des manières diverses. De l’écriture automatique des surréalistes aux versets de Saint-John Perse ou aux aphorismes de René Char, ce siècle des ruptures et des innovations artistiques a proposé bien des formes de poésie s’éloignant du langage versifié. On pourrait penser alors que la poésie devint une langue plus proche de celle que l’on parle quotidiennement. Ce ne fut pas le cas, car ce n’était pas l’ambition de la plupart de ces poètes. Même en prose, la poésie reste une langue particulière, ne serait-ce que par la brièveté de son propos, son contexte littéraire, son utilisation de certaines images, sa façon de jouer avec la syntaxe… Cette langue-là, on ne la parle pas non plus spontanément, même si certains, comme Raymond Queneau par exemple, ont feint de lui donner des allures de langue familière. Quant à certaines formes brèves, comme le haïku, même si elles visent la plus grande simplicité et l’expression du quotidien, elles peuvent déconcerter le lecteur — notamment occidental— par leur épure et leur esprit de concision assez éloignés de notre communication langagière.
Cette langue n’a donc rien d’ordinaire, sinon comme leurre, et il semble alors difficile d’affirmer avec Musset que " tout le monde la comprend ". Pourtant, en effet, la poésie parvient à nous toucher.
Il s’agit en fait de donner un sens au verbe " comprendre ". Le mot intelligence a pour étymologie le latin " inteligere " qui veut dire comprendre. Est-il pour autant question d’intelligence ? Les poètes ne sont pas tous d’accord, accordant à ce type de compréhension une importance variée. Entre Eluard disant " la poésie est la débâcle de l’intellect " et Valéry affirmant " la poésie est une fête de l’intellect ", il y a tous les degrés possibles. La poésie nécessite souvent, il est vrai, une maîtrise approfondie de la langue pour en saisir les écarts, les tours et les détours qui en font la matière stylistique. De plus, la poésie est souvent fondée sur des rapports d’intertextualité qui nécessitent une certaine culture littéraire pour en saisir les enjeux. Comment comprendre les effets d’imitation ou de parodie dans les sonnets de Ronsard si l’on ne sait rien de la poésie de Pétrarque, modèle de toute la poésie de la Renaissance ? Comment lire la litanie d’images que consacre André Breton au corps de la femme si l’on ne connaît rien de la tradition médiévale du blason féminin ? Les poèmes se répondent, se font écho par delà les siècles, et perpétuent une sorte de tradition même à travers les transgressions et les transformations de la modernité. Cette dimension n’est en effet accessible qu’à partir d’une culture minimale, en dépit de quoi la langue du texte peut nous rester étrangère.
Mais au-delà — ou en-deça— de cette " intelligence " du texte, la poésie nous touche parce qu’elle aborde des thèmes universels. La poésie peut s’arrêter sur le détail, mais souvent elle aime s’élargir à de vastes dimensions. Elle nous parle d’amour, de vie, de mort, de joie, de douleur, de désir, de nostalgie… Tout le monde est confronté d’une manière ou d’une autre à ces sentiments, et si nous n’avons pas vécu ce que vit et dit le poète, nous pouvons constater que l’art poétique parvient à nous communiquer des émotions par-delà même, parfois, la compréhension totale d’un texte. C’est le cas, par exemple, du chef-d’œuvre de Victor Hugo " Demain dès l’aube… " en, hommage à sa fille défunte, ou de la déclaration amoureuse de Paul Eluard dans " la courbe de tes yeux… ". Dirait-on que l’on " comprend " un morceau de musique ? Que l’on " comprend " un paysage ? La poésie est à la fois un paysage et une musique…
Guy Coffette, poète contemporain, dit dans une interview récente : " La poésie ne se comprend pas, elle se ressent ". La définition de Musset prend alors un sens un peu différent, car il s’agit de s’adresser aux sens, aux sentiments, à l’émotion. En effet, et notamment depuis les romantiques dont Musset est une illustration typique, la poésie est associée à l’expression de sentiments. Ce " lyrisme " passe par des procédés qui écartent ce langage de la langue prosaïque, mais le poète a pourtant la prétention d’atteindre le lecteur, un peu comme la flèche de Cupidon atteint les futurs amoureux… Privilégiant une relation au texte fondée sur la sensibilité, il n’est pas étonnant que le romantique Musset ait pu dire de la poésie que " tout le monde la comprend ". Plus que par l’intellect, cette compréhension passe par le cœur… Les formes contemporaines du genre ont parfois creusé un certain fossé avec le public mais on reste toujours frappé de voir à quel point les enfants et les adolescents, par exemple, sont réceptifs à ce type d’expression.
Sous un apparent paradoxe, la définition de Musset exprime donc parfaitement la vertu de cette langue si particulière dans le vaste champ des expressions humaines.
Il y a souvent quelque chose d’incompréhensible dans la relation que nous entretenons avec un texte, et cela est particulièrement vrai avec la poésie. Comme l’émotion musicale, dont elle est issue, la poésie nous " prend " avec elle, c’est à dire nous " comprend ". Ainsi, pourrions-nous dire, en renversant l’ordre des termes, qu’un texte atteint son but non pas quand nous le comprenons mais quand il nous comprend, c’est à dire exprime quelque chose qui est en nous, latent… et qui attendait ces mots pour être exprimés, pour venir au grand jour de notre conscience. Le poète parle alors pour nous, et nous sommes frères en humanité.
18:35 | Commentaires (0) | ![]() Facebook
Facebook
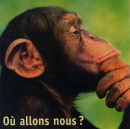


Les commentaires sont fermés.